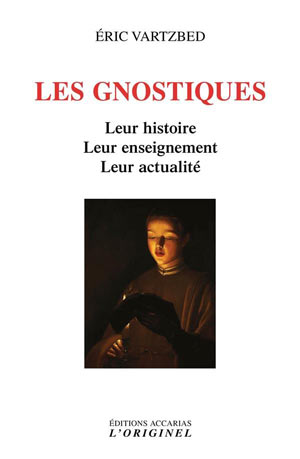Vu la grande confusion qui règne encore à propos de l’histoire du mouvement gnostique et les conclusions souvent baroques qu’on en tire, un ouvrage comme celui de David Brakke (traduit en français par Marie Chuvin) revêt une grande importance. Un certain nombre de points liés à ce sujet reste à clarifier en ce qui concerne la pensée occidentale sur le terrain de la spiritualité. En particulier, la nature des divergences entre monisme et dualisme et les conséquences concrètes de la mise en actes de ces deux cosmologies doit être régulièrement reprécisée — tout en laissant à chacun la liberté de se positionner selon sa propre sensibilité. L’analyse historique permet de prendre un certain recul vis-à-vis d’une problématique atemporelle qui relève finalement de la sensibilité individuelle. Pour cette raison, elle est déterminante dans l’adoption et l’application d’un cheminement spirituel ou initiatique. La question n’est pas en effet de savoir lequel des dogmes jugés canonique ou hérétique est le plus pertinent, mais ce que signifie pour chaque individu, dans sa vie et dans son cheminement, l’adhésion à l’une ou l’autre perception du cosmos. À ce titre, une information claire sur les données historiques s’avère essentielle. Or, l’auteur le précise : « le “gnosticisme” nous donne un superbe exemple de catégorie inventée par les spécialistes qui, faute d’avoir été clarifiée, a perdu son utilité et doit être abandonnée ou révisée. »
Petit rappel historique : « Aux alentours de l’an 100 après J.-C., de nombreuses communautés chrétiennes indépendantes apparaissent ; aucune ne convainc pleinement qu’elle a l’exclusivité du “vrai christianisme”. Elles se bousculent et se disputent pour obtenir ce titre. A posteriori, nous pouvons identifier le “cheval” qui sortira vainqueur et seul tenant de l’orthodoxie dominante à la fin du IIIe siècle ; c’est celui représenté par Irénée, Justin le Martyr, Clément d’ Alexandrie, Origène, Hippolyte de Rome, Tertullien (avant qu’il ne devienne montaniste), etc. On appelle cette forme de christianisme “proto-orthodoxie” parce que ce ne sont encore que les germes de l’orthodoxie naissante et que l’on regarde cette proto-orthodoxie défier et vaincre ses rivaux, se préparant à être le cheval de guerre de Constantin, si l’on peut dire. […] Il n’y avait pas de proto-orthodoxie uniforme, mais différentes piétés, autorités, théologies, présentées comme ses précurseurs par l’orthodoxie qui vient ensuite. » Et plus loin : « Dans nos études, l’établissement de l’hybridité comme norme vient brouiller la définition traditionnelle des gnostiques et autres premiers chrétiens.
De même, elle souligne l’enchevêtrement d’éléments culturels divers chez des personnages proto-orthodoxes, tel Irénée. Les ruptures, la continuité, ou encore l’évolution naturelle des croyances et doctrines naissantes que nous avions attribuées à certains groupes ne faisaient pas partie de leur vie sociale ; mais tous les chrétiens les invoquaient de façon rhétorique, engagés qu’ils étaient dans des processus complexes de formation identitaire et de définition limitative », une remarque qui pourrait s’appliquer tout autant à la situation des ritualités émergentes actuelles…
À ce stade de l’histoire du christianisme, la distinction entre orthodoxie et hérésie correspond donc avant tout à un discours sur l’identité religieuse, au sein d’un paysage très mélangé où les influences multiculturelles se croisaient. Brakke souligne combien les notions d’appartenance religieuse et d’identité ethnique étaient imbriquées dans les cultures antiques. Dans ce contexte, la vitalité du discours nicéen au IVe siècle (1er Concile de Nicée, 325) s’inscrit dans cette définition d’une claire identité chrétienne. À noter que la branche johannique, bien que validée par l’orthodoxie, se situe un peu à part du reste du corpus canonique et qu’elle semble restituer le contexte d’une communauté chrétienne d’orientation légèrement différente. La position de l’apôtre Paul est également spécifique : « Sans aucun doute, Paul révérait Jésus-Christ, et ses écrits forment maintenant une part importante de la Bible chrétienne. Mais Paul n’utilisait pas le terme “chrétien” pour se définir, non plus que “christianisme” pour son enseignement ; ces termes n’avaient pas encore été inventés, à notre connaissance. Il se considérait comme un juif prêchant l’accomplissement de la tradition juive, se rattachant fermement à l’histoire du judaïsme. Il est quelque peu trompeur de se servir des mots “chrétien” et “christianisme” à son égard. » Brakke conclut : « Aucune des formes du christianisme qui existaient aux IIe et IIIe siècles n’a subsisté intacte : elles ont toutes contribué, dans une proportion variable, au développement perpétuel du christianisme. »
Rappelons aussi que, comme l’explique d’ailleurs Irénée, pendant les premiers siècles de la chrétienté, la notion de rattachement quasi initiatique de l’église à laquelle on appartenait aux apôtres du Christ jouait un rôle décisif. On connaît ainsi des généalogies précises des évêques de Rome, et chaque tendance revendiquait la sienne. Cette habitude ayant été engagée par Basilide et Valentin, justement pour se légitimer vis-à-vis d’Irénée qui les considérait comme hérétiques. De là, l’idée qui subsiste encore dans certains cercles de traditions orales qui auraient été transmises par ces apôtres, puis leurs successeurs, et gardées secrètes. La tradition orale ayant effectivement joué un rôle majeur dans les cultures de la région jusqu’à cette époque, avant que l’on s’efforce d’en recueillir le plus possible par écrit pour la préserver, l’idée n’est pas étrange.
Comment appréhender aujourd’hui cette catégorie du « gnosticisme », dont on a vu qu’elle appelait une révision ? La perception actuelle découle en grande partie de celle présentée au colloque de Messine en 1966 : « Pour tous les participants, la “Gnose” renvoyait à l’idée générale d’un savoir réservé à une élite, par conséquent très répandue dans l’histoire des religions. Cependant, le véritable gnosticisme surgissait dans les systèmes qui s’apparentaient aux systèmes chrétiens du IIe siècle, et ils le définirent par “un ensemble cohérent de caractéristiques, soit deux idées primordiales :
1°) ‘une étincelle divine’ du royaume spirituel en l’humain, dont celui-ci doit prendre conscience ; et
2°) ‘une descente du divin’ (souvent appelé Sagesse) vers le royaume terrestre, pour recouvrer l’énergie divine perdue. Le gnosticisme associe ‘une conception dualiste sur un arrière-plan moniste, exprimé en un double mouvement de dévolution et d’intégration’. La ‘dévolution’ divine du gnosticisme l’empêchait d’appartenir au ‘même type historique et religieux que le judaïsme ou le christianisme du Nouveau Testament et la Grosskirche [‘la Grande Église’ ou ‘proto-orthodoxie’]’. Les conférenciers ont bâti sur ces fondations un gnosticisme qui n’était ni du judaïsme ni du christianisme, mais qui pouvait être apparenté aux Upanishad de l’Inde ancienne et aux cathares de l’Europe médiévale. »
Certains auteurs, comme Michael Williams et Karen King, optent carrément pour abandonner l’usage de cette catégorie, à cause du flou et des risques de mauvaise interprétation qu’elle comporte. Certains autres, comme Pearson, Markschies, etc., souhaitent la conserver pour y intégrer une large variété de mouvements chrétiens des origines. D’autres encore, comme l’auteur, préfèrent maintenir cette catégorie tout en la définissant mieux sur des bases historiques plus solides et sur une perspective différente qui nous paraît intéressante : plutôt que de se fonder sur une typologie doctrinale, souvent discutable et en constante évolution, Brakke choisit de se baser sur l’adoption ou non d’un mythe gnostique précis, tel qu’il a été décrit par Irénée dans ses textes contre les hérésies. S’appuyant sur un corpus précis (p. 70-72), Brakke parle donc d’une véritable « école gnostique ». Cette mythologie se distingue principalement par son positionnement dualiste : elle décrit à la fois d’un dieu suprême et transcendant, et la souveraineté exercée sur la matière par Ialdabaoth (terme parfois traduit par « matrice du vide »), un démiurge « créateur de ce monde », rapidement assimilé au « diable », c’est-à-dire le « diviseur »… Il s’agit donc effectivement, comme le décrivirent plus tard les cathares, de deux principes. Dès lors, d’incessantes querelles d’interprétation de textes ne pouvaient manquer de survenir : lorsqu’on parlait de dieu, auquel des deux principes faisait-on référence, consciemment ou non ? Et chacun de reporter le blâme et l’hérésie sur l’autre.
Il s’agit là d’une interprétation toute particulière de la complémentarité des dynamiques d’involution/évolution ˗ ou de « descente dans la matière » et « montée de l’esprit » ˗, car, dans cette interprétation mythologique, on observe une personnification symbolique des deux principes et un combat archétypal. Si une notion a été discutée durant les premiers siècles de notre ère, c’est bien celle-ci. On doit également repérer dans cette réflexion essentielle les prémisses d’une pensée très moderne : l’assimilation de la connaissance à l’activité intellectuelle (perte de sens progressive du concept d’“idée”) et l’accent mis sur l’action volontaire pour progresser sur la voie spirituelle, notamment en utilisant des méthodes ésotériques ou magiques. De fait, les pratiques de théurgie se sont répandues à cette période, notamment parmi les gnostiques néoplatoniciens. Cependant, à l’époque, la tendance était plutôt de considérer cette quête soit comme une élévation intellectuelle et philosophique, sur les traces de Platon, soit comme un parcours mystique plus conforme à la tradition judaïque, comme le fait remarquer Brakke.
À partir de cette manière de considérer les choses, qui embrasse une pluralité de religions et de ritualités en cours d’élaboration sur plusieurs siècles, en interaction ou en opposition les unes avec les autres pour mieux se définir tant par des emprunts mutuels que par des refus et excommunications, on peut voir se profiler, en filigrane des orthodoxies qui se sont graduellement imposées, la volonté de définir un ésotérisme non juif ˗ ou pas pleinement juif malgré les nombreuses références ˗ fortement imprégné de néoplatonisme et de dualisme protomanichéen. On constate cependant la présence de notions proches de celles exprimées dans la Kabbale (Shimon bar-Yohaï, auquel on attribue le Sefer ha-Zohar, a vécu au IIe siècle ; Isaac Louria au XVIe siècle), idées qui s’enracinent elles aussi dans une tradition juive plus ancienne, mais en contacts culturels permanents tant avec les idées platoniciennes qu’avec le contexte traditionnel mésopotamien. Les désaccords entre définition érudite d’un dogme et applications magico-pratiques, comme celles que nous avons décrites dans la note de lecture concernant la biographie du Baal Shem Tov ne datent donc pas d’hier. La manière dont l’ésotérisme initiatique se positionne dans ce panorama complexe est toujours particulièrement intéressante, d’autant plus que nombre de rites n’en ont une perception qu’assez partielle.
Ce qu’il faut retenir avant tout, c’est cette focalisation sur la notion de Gnose — Connaissance — qui correspond, selon les emplois qui ne s’excluent pas l’un l’autre, à la condition spirituelle permettant de « contempler Dieu en face » ou à la « réception de l’Esprit Saint (Sophia/Shekinah) ». Cet objectif ne s’inscrit évidemment pas forcément dans une spiritualité « gnosticiste” dans le sens d’une adhésion aux dogmes ou à la mythologie des gnostiques ; mais c’est une possibilité et, dans ce cas, un choix doctrinal. Dans cette perspective d’élévation (ou, dans une dynamique inverse, de « descente de la Sagesse »), l’école gnostique se comprend comme une voie ésotérique pratique fondée sur un comportement et des rituels précis. Cet ouvrage met par ailleurs bien en évidence la distinction entre la Gnose — connaissance obtenue par l’expérience mystique —, la foi qui est élan dévotionnel du cœur, et le rite dont la pratique sincère et assidue conduit à l’expérience.
La découverte de textes apocryphes chrétiens, en 1896 à Oxyrhynque, puis celle à Nag Hammadi, en 1945, de textes fortement imprégnés de pensée gnostique qui datent de la deuxième moitié du IVe siècle a beaucoup relancé l’intérêt des historiens et du public pour cette forme de spiritualité et favorisé une analyse fondée sur un corpus gnostique considéré comme une bibliothèque. En réalité, seul un petit nombre de ces textes s’inscrivent dans la stricte mouvance gnostique des IIe et IIIe siècles, les autres n’y étant qu’apparentés de près ou de loin. À la lumière d’une définition plus restrictive, on constate que le cas de Valentin ne permet pas de le classer parmi les gnostiques, bien qu’il se soit inspiré de certaines idées gnostiques. De même, Plotin est n’est pas considéré comme un gnostique puisqu’il proposait une autre voie d’union mystique qui a exercé une influence sur certains auteurs chrétiens comme Saint-Augustin ou le Pseudo-Denys.
Quant à l’émergence du mouvement gnostique, il se confirme de plus en plus que celui-ci est apparu au sein même du judaïsme, à une période où celui-ci comportait d’ailleurs une grande diversité d’interprétations et de rites. Reste à découvrir ce qui a provoqué une rupture d’interprétation aussi radicale que le fait de considérer que le « dieu d’Israël » devait désormais être assimilé au démiurge Ialdabaoth et non plus au dieu suprême… Il semble que certaines circonstances historiques, en particulier les défaites successives face aux Grecs et aux Romains, puis la double destruction du Temple, aient joué un rôle dans cette crise de la foi juive. Cette évolution permettrait de mieux comprendre les affinités qui n’ont pas tardé à suivre avec les premiers chrétiens, eux aussi dissidents du judaïsme traditionnel. Brakke examine avec soin les circonstances de cette émergence sans que les données historiques, trop rares, permettent de trancher avec certitude en faveur d’une hypothèse ou d’une autre.
Emmanuel Thibault
Source: La lettre du crocodile