Éprouver l'invisible dont se tisse le monde. Réflexions sur les formes écologiques du film (1910-1930)
Le naturaliste allemand Ernst Haeckel fut le premier à utiliser le terme d’écologie, en 1866, dans son ouvrage « Morphologie générale des organismes ». Ces questions relatives à l’humain, au vivant (bio), au monde sensible et à leurs interdépendances étaient alors totalement novatrices, et considérées comme très marginales. Trente années après naissait le cinématographe.
abonnez-vous pour un accès à tout le catalogue !

Benjamin Thomas, professeur en études cinématographiques, et spécialiste d'esthétique du cinéma, analyse dans cet exposé les unions que ponctuellement écologie et cinéma, alors naissants, ont pu entretenir. Avec, comme toile de fond, l’interaction du visible et de l’invisible.

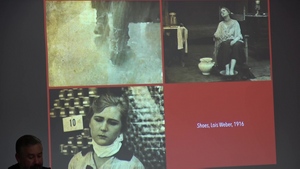
La science et la technique ont-elles sonné le glas de la pensée magique ?
Gilbert Simondon, (1924-1989, philosophe dont la pensée s’articule autour du terme d’individuation*), dans « Du mode d'existence des objets techniques » (1958, Ed. Aubier-Montaigne), postule que l'apparition de la pensée technique a clivé l'appréhension originelle du monde par l'humain, cette « pensée magique », qui ne distinguait pas figure et fond.
La pensée technique entérine l'idée d'une figure indépendante de tout fond : elle considère que des éléments, les objets techniques, sont mobilisables et manipulables en tout contexte, donc indépendants de tout lieu. En réponse, la pensée religieuse s'affirme en prenant en charge les puissances de fond : c'est une pensée de la totalité en laquelle, idéalement, toute singularité doit se résorber voire être niée. Or, la pensée esthétique, selon Simondon, naît au point de disjonction de ces deux modes de pensée. Elle cherche à réactiver l'interdépendance de la figure et du fond. Elle opère en l'humain avant même qu'il élabore des objets esthétiques.
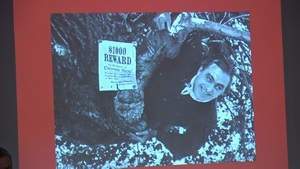

Mais la pensée esthétique, fondamentalement analogique, façonne ses produits comme autant de composés d'affects et de percepts de corrélation. Si l'on suit Simondon, il n'est pas étonnant que les images constituent un lieu privilégié pour donner à éprouver des réalités puissamment relationnelles. Parmi ces réalités intangibles, il y a bien évidemment ce fond connectif, ce milieu d'interdépendances qu'est la condition écologique, la condition d'existence même des formes du vivant.
Or il semble que le cinéma tente, assez tôt en fait, de donner à éprouver cet invisible, qu'il y traite de questions explicitement environnementalistes ou non.
Benjamin Thomas se propose de vérifier cette hypothèse auprès de films aussi différents que La Fin du monde (Verdens Undergang, 1916, Auguste Blom) ou L'Heure suprême (Seventh Heaven, 1927, Frank Borzage), parmi bien d'autres.
* individuation à ne pas confondre avec celle du psychanalyste Carl Gustav Jung, mais comme « comprendre les êtres (vivants, techniques, psychiques) non comme des substances données, mais comme des processus en devenir au sein d’un milieu ».
--------------------------------------
Exposé issu du colloque : Raconter et montrer l'Invisible à la croisée de la littérature, des arts de la scène et du cinéma (1850-1930), août 2024. Direction scientifique : Julie Anselmini, Yann Calvet et José Moure. Réalisé avec le soutien de :
• UFR "Humanités et Sciences Sociales" (HSS) | Université de Caen Normandie
• Laboratoire "Lettres, Arts du Spectacle, Langues Romanes" (LASLAR - UR 4256) | Université de Caen Normandie
• Institut "Arts Créations Théories Esthétique" (ACTE - UR 7539) | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
• Caen la mer Normandie

