La permanence de l'invisible féminin dans l'œuvre de Théophile Gautier
Théophile Gautier n'a jamais cessé d'être fasciné par les mondes de l'irréel au sein desquels se meuvent de "mystérieuses et fantastiques créatures" : féminines, fantasmes d'amour et de beauté (La Cafetière, 1831). L’esprit des héros mélancoliques de ses récits sont marqués par une grande disponibilité au surnaturel, à cet extra-monde, cher à son prédécesseur, Swedenborg.
abonnez-vous pour un accès à tout le catalogue !

Ces "apparitions insaisissables" (Giselle ou les Wilis, 1841) envahissent la production narrative de ses romans, de ses nouvelles, jusqu'à ses livrets d'opéra.

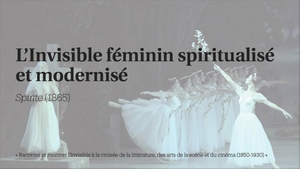
La figure de proue de ce merveilleux féminin : la sylphide.
Le goût proprement romantique de l'auteur pour ces figures de sylphides réappropriées ne faiblit pas avec les années et cela, malgré le déclin d'intérêt pour le mouvement littéraire et artistique de sa jeunesse.
S'agit-il d'une nostalgie désespérée de l'auteur ou bien d'un choix esthétique procédant d'une résistance, par le principe d’amplification de ses thèmes de prédilection, face à l'influence croissante du réalisme dans le champ littéraire et artistique depuis les années 1850 ?


« L’art pour l’art » : du romantisme au sciences occultes
Cette fidélité de Théophile Gautier aux personnages de fantômes féminins permet à Samantha Caretti de mettre en lumière l'influence de son attrait soutenu pour les sciences occultes, d'interroger l'équivocité de son geste créateur dans la représentation du surnaturel et d'étudier sa capacité à donner accès, par l'art, à l'invisible…
--------------------------------------
Exposé issu du colloque : Raconter et montrer l'Invisible à la croisée de la littérature, des arts de la scène et du cinéma (1850-1930), août 2024. Direction scientifique : Julie Anselmini, Yann Calvet et José Moure. Réalisé avec le soutien de :
• UFR "Humanités et Sciences Sociales" (HSS) | Université de Caen Normandie
• Laboratoire "Lettres, Arts du Spectacle, Langues Romanes" (LASLAR - UR 4256) | Université de Caen Normandie
• Institut "Arts Créations Théories Esthétique" (ACTE - UR 7539) | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
• Caen la mer Normandie

